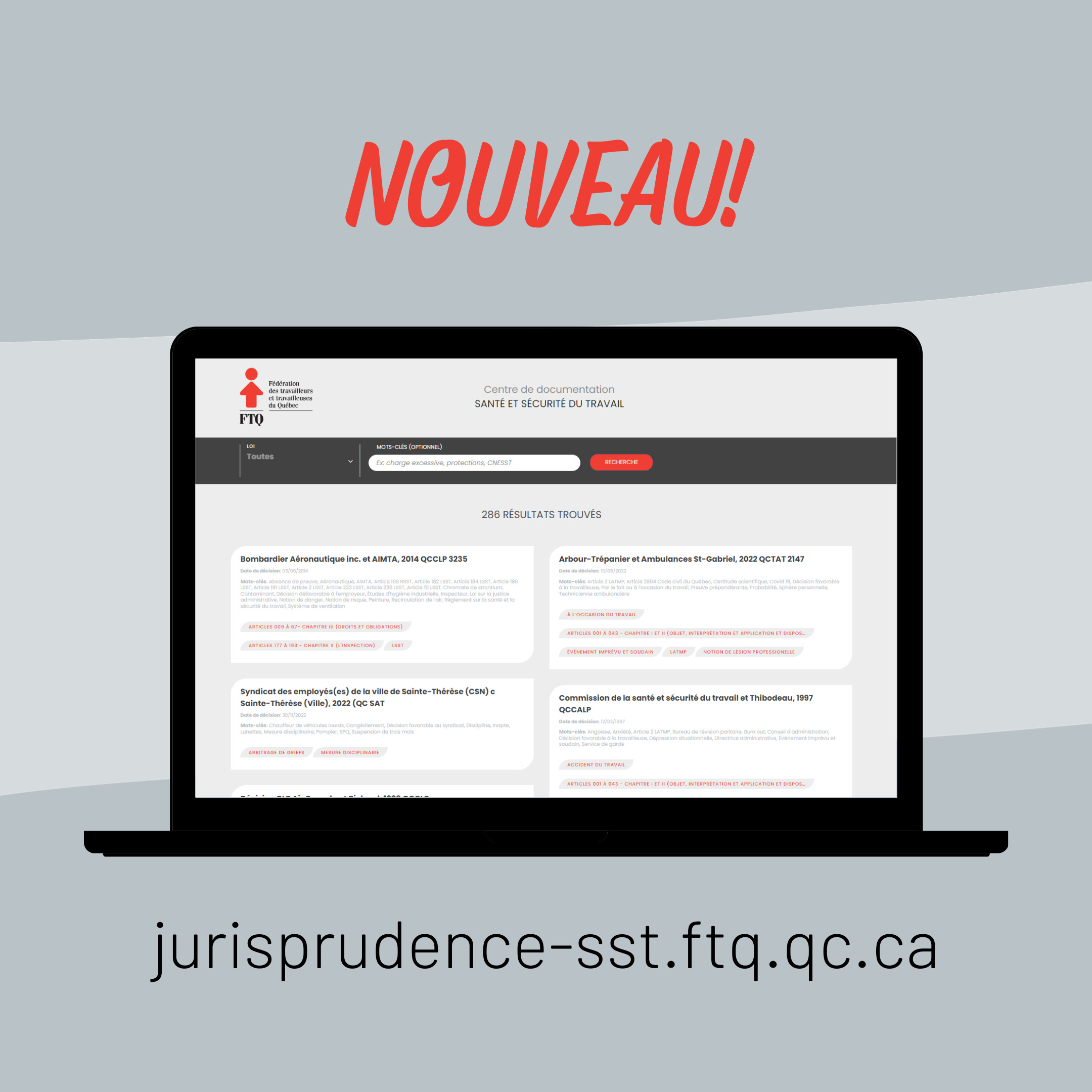Un peu d’histoire sur les décrets de convention collective
La Loi sur les décrets de convention collective a été adoptée en 1934 par le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau sous le nom de Loi de l’extension juridique des conventions collectives. Première loi générale en matière de travail, elle précède la Loi sur les relations ouvrières adoptée en 1944, l’ancêtre du Code du travail (1964), et la Loi sur les normes du travail (1979).
C’est à la demande de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), l’ancêtre de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) que la Loi est adoptée. Elle a alors pour but de promouvoir le syndicalisme et d’améliorer les conditions de travail misérables des ouvriers. Ceux-ci sont infligés par l’échec du capitalisme durant la crise économique des années 1930. Pendant cette période, le taux de chômage bondit au Québec passant de 7,5% en 1929 à 30% en 19331. C’est plus de 230 000 travailleurs qui sont touchés par les pertes d’emplois. Simultanément, dans le même intervalle, le revenu moyen par habitant diminue d’environ 44%.
La Loi de l’extension juridique des conventions collectives cherche à mettre un frein à cette chute des conditions salariales en permettant, par décret, d’étendre à tout un secteur d’activité, dans une région donnée, les conditions de travail négociées par un syndicat. Autre particularité, la Loi mise sur le paritarisme. L’application d’un décret est assurée par un comité paritaire formé de représentants syndicaux et patronaux.
Lors de la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale, le 8 février 1934, le ministre du Travail, Charles-Joseph Arcand résume bien les objectifs de cette nouvelle législation qui vise à juguler la concurrence déloyale et contribue, du même coup, à accroître la légitimité des syndicats et de la négociation collective2 :
«À l’heure actuelle, les ouvriers unionistes veulent des conventions collectives qui garantissent la stabilité des salaires. Des employeurs sont disposés à négocier. Toutefois, ils hésitent, ils se refusent, car ils prévoient de toute évidence qu’ils se placent sur un pied d’infériorité par rapport à leurs concurrents. Comment un entrepreneur peut-il s’engager pour une année à payer ses menuisiers 75 sous de l’heure, alors que ses concurrents ne paient que 60 ou 40 sous? Peuvent-ils, à chance égale, présenter une soumission pour une entreprise à forfait? Évidemment non. Alors, on ne signe plus de contrat de travail, et les organisations ouvrières périclitent, faute de pouvoir protéger leurs membres. Et les employeurs honnêtes ne peuvent plus tenir contre les employeurs rapaces. Il faut donc protéger de toute nécessité la convention collective de travail. Il faut donc que les patrons s’organisent, de même que les ouvriers. Plus de crainte d’une concurrence déloyale; l’État intervient pour la supprimer en obligeant les individualistes à emboîter le pas à la suite des coopérateurs. Est-il vraiment possible pour l’État de mieux favoriser la collaboration du capital et du travail?»
La Loi est un véritable gain pour le mouvement syndical. Il sera en revanche de courte durée. Peu de temps après son adoption, la Loi sera refondue en 1936 et renommée Loi relative aux salaires des ouvriers suivant l’arrivée au pouvoir de Maurice Duplessis. Désormais, le gouvernement s’octroie le droit de modifier ou d’abroger un décret sans consulter les syndicats ou les employeurs. L’année suivante, toute clause d’affiliation syndicale ou d’atelier fermé seront prohibés3.
Toutefois, le retour au pouvoir des libéraux d’Adélard Godbout en 1939 permettra, sous la pression des syndicats, de rétablir en bonne partie les objectifs initiaux de Loi qui prendra l’appellation, en 1940, de Loi de la convention collective. On rappellera alors que le but de celle-ci est d’«adopter, étendre et rendre obligatoires les conditions de travail consignées dans les conventions collectives, tant pour prévenir la concurrence déloyale faite au signataire que pour établir le juste salaire et satisfaire l’équité.»4
Depuis l’attaque du gouvernement Duplessis, la Loi sur les décrets de convention collective a survécu au passage du temps. Cependant, certains événements lui ont fait perdre de son lustre et de sa vitalité comme discuté dans la prochaine section.
Notes de bas de page
1. Ministère du Travail du Québec. (2011). Les 80 ans du ministère du Travail. Au diapason d’une société en évolution. Québec : Bibliothèque nationale du Québec, p.13.; http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/462.html, consulté le 21 juillet 2021.
2. Assemblée nationale, Débats de l’Assemblée législative, 18e législature, 3e session, vol. 1, séances du 9 janvier au 8 mars 1934, le 8 février, p.202 (M.Arcand); Hennebert, Marc-Antonin, Urwana Coiquaud et Lucie Morissette (2016). Relations de travail. Montréal : Chenelière Éducation, 314p.
3. Rouillard, Jacques. (1989). Histoire du syndicalisme québécois. Montréal : Boréal, p.172.
4. Beaulieu, Marie-Louis. (1955). Les conflits de droit dans les rapports collectifs de travail, Québec : PUL, p.139, cité par Fontaine, Laurence Léa. (2018). « L’histoire de l’extension des conventions collectives au Québec », Le régime des décrets de convention collective au Québec. Quel avenir?, J.Bernier, dir. Montréal : Éditions Yvon Blais, p.27.