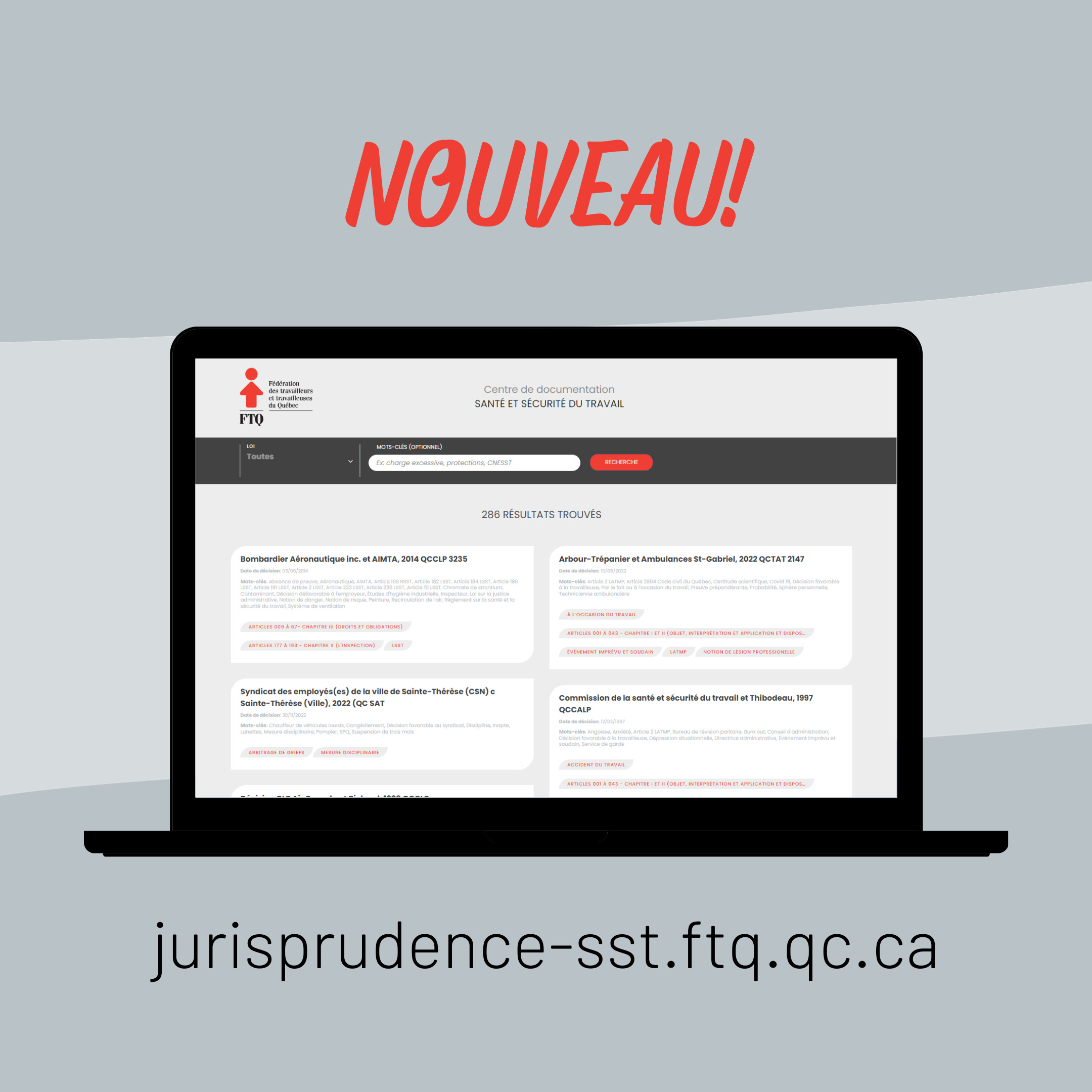Évolution des décrets de convention collective et position de la FTQ
Dès son adoption, La Loi sur les décrets de convention collective suscite l’intérêt des syndicats et des employeurs dans les secteurs industriels et commerciaux (construction, chaussure, imprimerie et alimentation)5. Cependant, l’adoption, en 1944, de la Loi des relations ouvrières (LRO), ancêtre du Code du travail, qui crée un véritable régime d’accréditation syndicale par établissement ainsi que l’obligation de négocier de bonne foi, fragilise la loi sur les décrets. En effet, plusieurs grandes entreprises et syndicats ont transféré leur convention collective assujettie au régime des décrets à celui de la LRO, car plus adapté à leur situation6. Et depuis les années 1960, force est de constater un rétrécissement de la couverture des décrets. Parmi les événements les plus importants pour expliquer cette chute, notons le retrait en 1968 de 16 décrets couvrant plus de 100 000 personnes salariées dans le secteur de la construction qui sera désormais régi par la Loi des relations de travail dans l’industrie de la construction. Puis, avec l’adoption de la Loi sur les normes du travail en 1979 qui impose des conditions minimales de travail à l’ensemble des employeurs de la province, la pertinence du régime des décrets est remise en question7.
La LDCC survivra néanmoins à la LNT et sera même modernisée en 1984 à la demande des parties et des comités paritaires. Parmi les modifications introduites, il y a celles visant à interdire à un employeur «de payer un salaire inférieur à celui fixé par décret, à assurer la continuité entre l’ancien et le nouveau propriétaire quant aux sommes dues à un salarié dans le cas d’un changement à la structure juridique de l’entreprise (…), à augmenter le montant des pénalités…»8.
Position de la FTQ
Cependant, quelques années plus tard, en 1988, le Conseil général de la FTQ adopte une résolution d’urgence sur la LDCC. Cette période est marquée par une montée du néolibéralisme. Le gouvernement libéral au pouvoir mande un groupe de travail pour «formuler des recommandations destinées à placer les entreprises du Québec dans une situation au moins aussi avantageuse que celles de l’Ontario en ce qui concerne les conditions réglementaires qui affectent leur productivité.»9. Suivant la publication du rapport de ce comité (dit rapport Scowen du nom du président du Groupe, Reed Scowen, député libéral), la FTQ craint que la LDCC soit abolie comme en fait foi l’encadré ci-dessous.10
Les efforts de la FTQ ont porté fruit dans la mesure où la Loi ne fût pas abolie. Néanmoins, le nombre de décrets a continué à diminuer lentement, mais sûrement. Puis, en 1996, le gouvernement décide de réviser cette pièce législative et en particulier les critères d’évaluation pour émettre ou renouveler un décret. Désormais, le contexte de concurrence internationale, le maintien et la création d’emplois ainsi que les impacts sur la gestion seront pris en considération. Une convention collective ne pourra ainsi faire l’objet d’une extension juridique si elle se traduit par un « inconvénient sérieux pour les entreprises en concurrence avec des entreprises établies à l’extérieur du Québec »,11 si elle nuit à l’emploi et se traduit par un alourdissement de la gestion. Le processus de révision administratif est aussi revu. Le ministre du Travail est mandaté pour faire rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la Loi, exercice qu’il doit mener en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce. Ce dernier est appelé à se prononcer sur la pertinence de maintenir le secteur manufacturier sous la gouverne de la LDCC.
Ces changements traduisent la volonté du gouvernement d’insuffler des critères purement économiques et d’affaires dans une Loi qui vise d’abord et avant tout à octroyer de meilleures conditions de travail à des personnes salariées. Il en résultera l’abolition de 9 décrets entre 1996 et 2000 dont quatre dans le secteur du vêtement (gant de cuir, chemise pour hommes et garçons, confection pour hommes et pour dames) lesquels régissent alors les conditions d’emploi d’environ 23 000 travailleurs et travailleuses.
Cette refonte de la Loi a donc eu pour effet d’éliminer pratiquement tous les décrets dans le secteur manufacturier dans la mesure où le critère de la compétitivité a dominé le processus d’évaluation du régime. Cette évolution témoigne de l’influence politique accrue des associations d’employeurs sur le contenu des lois du travail12.
Depuis, d’autres décrets ont été abolis, le plus récent étant celui des coiffeurs de la région de l’Outaouais. Puis, en 2023, à la suite longues démarches, un nouveau décret est entré en vigueur, le décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière. Il ne reste donc à ce jour que 15 décrets de convention collective au Québec dans 9 secteurs. La FTQ est présente dans 13 de ces décrets dont les trois plus importants sont l’entretien ménager, la sécurité et l’automobile.
À ce moment-ci, il est légitime de se demande si ce régime de décrets qui survit en parallèle au Code du travail, à la Loi sur les normes du travail et autres lois du travail, est toujours nécessaire et utile pour le mouvement syndical. L’évolution des décrets depuis l’adoption de la Loi tend bien à démontrer que sa couverte se réduit comme peau de chagrin. Au fond, est-il toujours justifié de maintenir ces décrets? Ne serait-il pas préférable pour la FTQ et ses affiliés de mettre leurs énergies sur la syndicalisation de nouvelles unités et la réforme du Code du travail? Pour la FTQ, la réponse à ces questions est sans équivoque comme nous le verrons dans la section suivante.
Une loi toujours d’actualité?
Pour la FTQ, il fait nul doute que la Loi sur les décrets de convention collective demeure une pièce législative majeure pour les relations de travail en tandem avec le Code du travail. Les deux régimes ne sont pas en opposition, mais bien en complémentarité, comme nous le verrons plus en détail dans les sections suivantes (processus d’adoption d’un décret et mythes sur la LDCC).
De plus, la LDCC permet toujours aux syndicats affiliés à la FTQ d’asseoir leur légitimité et leur influence dans de nombreux secteurs d’activités et demeure un outil à la portée des syndicats pour mieux représenter les travailleurs et travailleuses.
En fait, la Loi vise deux objectifs qui sont toujours d’actualité et chers au mouvement syndical et à la FTQ:
- Elle assure des conditions de travail décentes aux salariés des secteurs d’activités visés par un décret de convention collective;
- Elle atténue la concurrence déloyale entre les entreprises des secteurs très exigeants en termes de mobilités et de qualification de la main-d’œuvre. Elle permet ainsi d’éviter que la compétition entre entreprises ne se fasse sur le dos des travailleurs prévenant du même coup le dumping social.
C’est d’ailleurs pourquoi la FTQ «[…] milite sans réserve pour le maintien et la bonification du régime de décrets de convention collective, en raison de sa capacité à améliorer la situation des travailleurs et des travailleuses vulnérables et à accroître leur participation à la détermination de leurs conditions de travail13». Pour preuve, des syndicats affiliés avec l’appui de la FTQ ont entamé des démarches pour l’obtention d’un décret :
- SQEES-298, UES-800, Syndicat des Métallos, Teamsters, Unifor et TUAC pour les résidences pour personnes aînées (RPA);
- SQEES-298 pour les entreprises d’économie sociale en aide à domicile.
En résumé, la LDCC est née d’une volonté du mouvement syndical et du gouvernement d’apporter une solution aux conditions déplorables des personnes salariées pendant la crise de 1930 en mettant un frein à la concurrence que se livraient les entreprises au mépris des travailleurs et travailleuses. Elle a aussi marqué un premier pas dans l’établissement d’un régime de relations de travail qui reconnaissait des vertus au syndicalisme, à la négociation collective et au paritarisme. La LDCC a ainsi permis à des centaines de milliers de personnes salariées de travailler dans la dignité et a donné l’opportunité aux syndicats de jouer leur rôle d’agent négociateur pour une meilleure justice sociale. Cette mission, la LDCC la remplit toujours depuis maintenant plus de 90 ans! La prochaine section permettra de plonger dans la mécanique de la Loi et ainsi de mieux en comprendre les tenants et aboutissants et les avantages pour le mouvement syndical.
Notes de bas de page
5. Fontaine, Laurence Léa. (2018). « L’histoire de l’extension des conventions collectives au Québec », Le régime des décrets de convention collective au Québec. Quel avenir?, J.Bernier, dir. Montréal : Éditions Yvon Blais, p.24.
6. Hébert, Gérard (1990). « Le renouvellement du régime des décrets de convention collective », Relations industrielles, vol. 45, no 2, p.404-413.
7. Supra, note 9, p.31.
8. Supra, note 9, p.32.
9. http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3268.html, consulté le 27 juillet 2021.
10. 1988; Procès-verbal; Conseil général de la FTQ, avril, résolution d’urgence, page 2. Récupéré dans Jasmin-Lortie, Vanessa (2009). Répertoire des politiques officielles de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, 407p.
11. Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ, c. D-2, art. 6, no 2.
12. Vallée, Guylaine et Jean Charest (2001). « Globalization and the Transformation of State Regulation of Labour: the Case of Recent Amendments to the Quebec Collective Agreement Decrees Act”, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 17, no 1, 79-91.
13. Côté, Lise (2018), « La LDCC : un outil de lutte contre les inégalités sociales », Le régime des décrets de convention collective au Québec – Quel avenir?, J.Bernier, éd. Montréal : Éditions Yvon Blais, p.73.