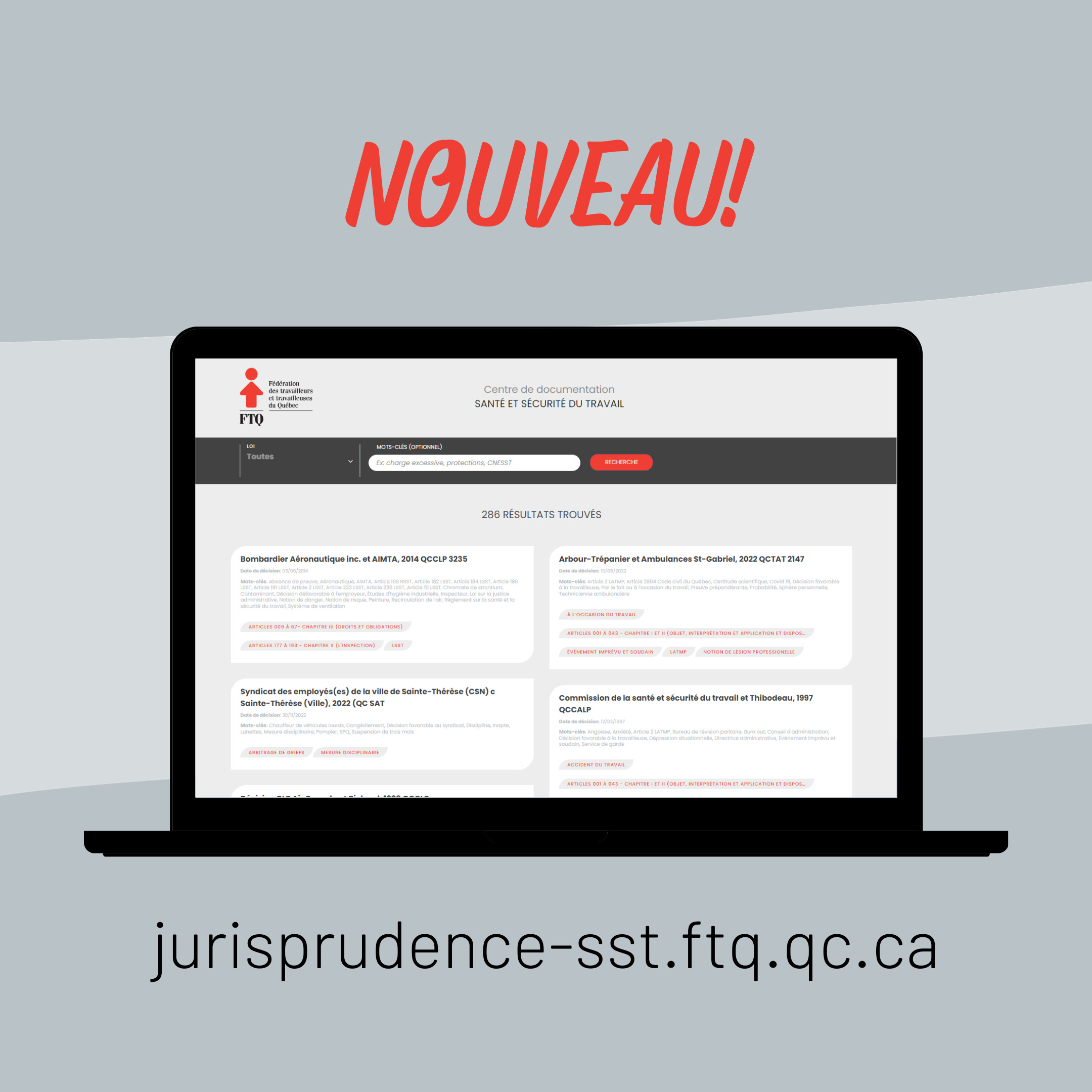Quelle est la différence entre un décret et un décret de convention collective?
On peut distinguer principalement deux types de décrets en relations de travail. La confusion entre les deux peut mener à une évaluation négative des décrets de convention collective alors qu’il devrait en être tout autrement. Faisons la lumière sur cette question en précisant la nature des décrets gouvernementaux et en les différenciant des décrets de convention collective.
Les décrets gouvernementaux nuisibles à la liberté de négociation collective
Un décret se définit comme étant une «Décision réglementaire écrite émanant du pouvoir exécutif14». De par sa nature, il dépouille les parties, en particulier les syndicats, de tout droit à la négociation des conditions de travail de ses membres. L’État impose alors celles-ci au détriment de droits fondamentaux reconnus en droit du travail, celui de la libre négociation et de l’exercice du droit de grève. Certains se rappelleront amèrement les décrets de 1982 (voir l’encadré 1 ci-dessous) ou plus récemment la loi 142 (2005) qui décréta, notamment, les augmentations de salaire accordées aux employés de l’État15.
Les décrets de 1982-1983
| 1982-1983 |
|---|
| Imposition par décret gouvernemental des conditions de travail des employés des secteurs public et parapublic Un an avant l’échéance de la convention collective, le gouvernement impose les salaires des employés de l’État et leurs conditions de travail à coups de décrets. Il va jusqu’à suspendre la Charte des droits et libertés de la personne pour forcer les enseignants à retourner au travail et à accepter ses conditions. La défaite des syndicats des secteurs public et parapublic qui étaient à l’avant-garde du mouvement syndical jusque là, marque l’entrée dans une nouvelle époque où ils sont acculés à la défensive. Source : La ligne du temps CRHA : http://lignedutemps.org/# |
Ce type de décrets est naturellement décrié par la FTQ, car ils superposent à la négociation libre une détermination unilatérale des conditions de travail. Un droit que s’octroie l’État lorsqu’il porte les habits de l’employeur.
Les décrets qui soutiennent la négociation collective
À l’inverse, un décret de convention collective se comprend comme « une convention collective étendue juridiquement qui lie des employeurs et des salariés syndiqués ou non œuvrant dans un secteur d’activité spécifique dans une région donnée. Les dispositions d’un décret sont d’ordre public et, en conséquence, on ne peut y déroger. »16
Exemple de renouvellement d’un décret de convention collective
| « Le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité touche environ 22 500 travailleurs et quelque 215 employeurs, qui sont respectivement représentés au sein du Comité paritaire des agents de sécurité par le Syndicat des Métallos, section locale 8922 de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), et par l’Association provinciale des agences de sécurité. Les modifications proposées permettent, entre autres, une hausse salariale moyenne de 1,66 % par année jusqu’en juillet 2022, la création d’un régime enregistré d’épargne-retraite collectif, l’ajout d’une semaine de congé ainsi que la rémunération des congés de maladie. »17 |
Ce type de décret est reconnu comme pleinement légitime par la FTQ, car il s’appuie sur une négociation entre la partie patronale et syndicale en vue d’octroyer de meilleures conditions de travail aux salarié(e)s d’un secteur d’une région donnée.
En somme, contrairement à un décret gouvernemental qui vise à imposer des conditions de travail, les décrets de convention collective ont pour effet d’étendre certaines dispositions d’une convention collective négociée18 entre un ou des syndicats et un employeur ou une association d’employeurs à tous les salariés et employeurs d’un secteur d’activité et dans une région déterminée. Ces derniers viennent donc appuyer le droit à la négociation, notamment dans les secteurs caractérisés par une vive compétition qui a pour effet de freiner les gains syndicaux.
Qui est couvert par un décret de convention collective?
Partant de la définition ci-dessus, le décret de convention collective couvre les personnes salariées d’un secteur et d’une région donnée suivant une négociation entre un ou des employeurs ou un ou des syndicats. Mais est-ce qu’il s’applique uniquement aux entreprises et aux travailleuses et travailleurs syndiqués comme c’est le cas pour une négociation de type «pattern bargaining» ou coordonnée?
La réponse est non et c’est ce qui fait justement la particularité de la LDCC. Dès qu’une convention collective fait l’objet d’une extension juridique en vertu de la Loi, toutes les entreprises du secteur et de la région visés doivent respecter les conditions de travail minimales prévues au décret (salaires, primes, temps de travail…) que leurs salarié(e)s soient représentés ou non par un syndicat.
Le décret de convention collective se veut ainsi un régime hybride entre le Code du travail et la Loi sur les normes minimales du travail qui permet aux entreprises syndiquées d’offrir de meilleures conditions que ce qui est prévu dans les différents décrets.
Quel est le processus menant à l’adoption d’un décret de convention collective?
L’extension d’une convention collective en décret n’est pas un processus automatique. Il doit passer par une série d’étapes et d’évaluations qui relèvent du ministre du Travail selon des critères définis19. Nous décrirons ci-dessous le processus d’adoption d’un nouveau décret comme prescrit par la Loi tout en sachant que d’autres processus coexistent reflétant une pratique historique dont la légitimité est reconnue20.
- Un syndicat et un employeur ou une association d’employeurs négocient une convention collective;
- Une fois ratifiée, toute partie à la convention collective (syndicat ou employeur) peut demander au gouvernement l’extension de cette entente, ou une partie de celle-ci, à l’ensemble d’une industrie dans une région donnée. La demande doit être acheminée au ministre du Travail avec une copie de la convention qui tiendra lieu de décret et le cas échéant, la convention collective sur laquelle est fondée celle-ci.
- Le ministre peut alors demander aux parties tous les renseignements jugés utiles pour lui permettre d’évaluer la demande. La recevabilité de celle-ci est évaluée suivant une analyse préliminaire des critères précisés aux articles 6, 9 et 9.1 de la Loi. Parmi les principaux, mentionnons :
- Le caractère approprié du champ d’application du décret (secteur, région…). Sera alors évaluée la nature du travail, des produits et des services, des caractéristiques du marché visé par la demande et du champ d’application des autres décrets;
- Les dispositions du décret ont acquis une signification et une importance prépondérante pour l’établissement des conditions de travail;
- Le décret peut être étendu sans inconvénient sérieux pour les entreprises en concurrence avec celles établies à l’extérieur du Québec;
- Le décret n’a pas pour effet de nuire, de façon sérieuse, au maintien et au développement de l’emploi dans le champ d’application visé;
- Les dispositions prévues n’ont pas pour effet d’alourdir indûment la gestion des entreprises par l’introduction d’une classification des opérations ou différentes catégories de salariés.
- Si le ministre juge la demande irrecevable, il doit en informer la partie demanderesse de son intention et des motifs au soutien de sa décision. Il doit aussi donner l’occasion à celle-ci de présenter ses observations et produire, s’il y a lieu, des documents pour compléter ladite demande.
- Dans l’éventualité où le ministre juge la demande recevable, il fera publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de réception de celle-ci et le projet de décret s’y rapportant. L’avis devra aussi être publié dans un journal de langue française et anglaise au frais du demandeur. Toute objection au projet de décret doit être formulée dans les 45 jours de sa publication.
- Au terme de ce délai, le ministre
- Informe le demandeur par écrit qu’il ne recommande pas l’approbation de la demande par le gouvernement en indiquant les motifs de sa décision
OU - Recommande au gouvernement de décréter l’extension de la convention, avec modifications, le cas échéant, après examen attentif des critères mentionnés au point 3 ci-dessus.
- Informe le demandeur par écrit qu’il ne recommande pas l’approbation de la demande par le gouvernement en indiquant les motifs de sa décision
- Le décret entre en vigueur à compter du jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée. Un comité paritaire doit alors être créé.
Bien que certains délais soient prescrits dans la Loi, notamment pour la publication d’un avis de réception et de demande de projet de décret, l’expérience des syndicats affiliés à la FTQ démontre qu’il peut prendre plusieurs mois, voire années pour l’adoption d’un décret ou encore sa révision. La Loi ne précise aucun délai au gouvernement pour le traitement des requêtes.
Processus de requête d’un décret de convention collective prévu à la Loi sur les décrets de convention collective
Qui surveille l’application d’un décret? La CNESST? Le TAT?
Ni l’un ni l’autre. L’application et la surveillance d’un décret relèvent d’un comité paritaire.
Ce comité est formé à parts égales de représentants des syndicats et des employeurs.
À cette fin, le comité dispose, notamment, des pouvoirs suivants :
- Procéder à des inspections dans tout lieu de travail ou établissement de tout employeur visé par un décret en vue d’assurer son application;
- Exercer des recours en vertu du décret en faveur des salariés;
- Recouvrer de l’employeur qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé.
La Loi confère d’autres pouvoirs au comité tel qu’aviser et informer les salariés et les employeurs des conditions de travail du décret et leur exiger une cotisation pour s’autofinancer.
En somme, un décret de convention collective s’appuie sur une négociation entre les parties patronale et syndicale. La LDCC s’inscrit ainsi dans les principes fondateurs des relations de travail puisqu’elle cadre la détermination des conditions de travail dans une logique d’action collective où un syndicat accrédité négocie avec un employeur. Elle confie en plus des pouvoirs importants aux parties prenantes en leur permettant de veiller elles-mêmes à l’application et la surveillance de leur décret. L’État intervient seulement pour évaluer la pertinence d’adopter un décret dans un secteur.
Notes de bas de page
14. Assemble nationale du Québec, Encyclopédie du parlementarisme québécois, Décret – Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca), consulté le 21 juillet 2021.
16. Secrétariat du travail, http://www.travail.gouv.qc.ca/faq/decrets-de-convention-collective/, consulté le 13 juillet 2021.
18. Sauf exception du secteur automobile. Dans ce cas particulier, les parties négocient sur la base du décret existant. « Cette pratique est le fruit d’une tradition qui s’est développée au sein d’un comité paritaire et est parfois rendue nécessaire en raison du fait que le décret assujetti plusieurs types d’entreprises dont la réalité ne pouvait être prise en compte dans le contexte d’une négociation traditionnelle au sens du Code du travail ». Source : Travail Québec (2014). Rapport sur la consultation relative à la Loi sur les décrets de convention collective, Juin, p.7. http://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/Rapport_sur_la_revision_de_la_LDCC.pdf, consulté le 13 juillet 2021.
19. Il est à noter qu’un processus de renouvellement de décret de convention collective suit une démarche différenciée qui n’est pas précisé aussi clairement dans la Loi.
20. Voir explications, Supra, note 20.